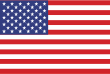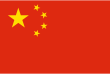Definition
Une attaque de la chaîne d’approvisionnement logicielle se produit lorsque des acteurs malveillants insèrent des logiciels malveillants ou des codes altérés dans le processus de développement ou de livraison de logiciels, en ciblant souvent les dépendances de tiers. Ces attaques exploitent les relations de confiance entre les développeurs, les outils et les composants, offrant ainsi aux attaquants un moyen furtif et évolutif de compromettre les systèmes.
Comprendre les attaques de la chaîne d’approvisionnement logicielle
Contrairement aux menaces cybersécurité classiques qui visent le périmètre, comme les pare-feu, les terminaux (endpoints) ou les points d’accès réseau, les attaques de la chaîne d’approvisionnement logicielle exploitent la confiance interne entre systèmes et outils. Ces attaques n’ont pas besoin de franchir les pare-feu : elles s’incrustent dans le code et les packages que les développeurs croient sûrs. En intégrant des composants malveillants dans les outils de développement ou les dépendances du code source, les attaquants peuvent compromettre les logiciels bien avant qu’ils n’atteignent le stade de la production.
Les pipelines CI/CD sont une cible de plus en plus attrayante. Les attaquants peuvent injecter des scripts malveillants dans les processus de build ou altérer les outils d’automatisation, tels que Jenkins ou GitHub Actions. Ces pipelines, conçus pour la vitesse et l’efficacité, manquent souvent de contrôles de sécurité stricts, ce qui les rend vulnérables à des compromissions subtiles qui se répercutent sur de multiples applications.
Les attaques contre la chaîne d’approvisionnement logicielle exploitent la nature interconnectée du développement moderne. Plutôt que de frapper les systèmes directement, les attaquants visent l’amont, en compromettant les composants, outils ou bibliothèques utilisés pendant la création logicielle. L’objectif est d’insérer un code malveillant qui atteint les environnements de production sans être détecté.
Les attaquants compromettent souvent les bibliothèques open source, injectent du code empoisonné dans les images de conteneurs, manipulent les pipelines CI/CD ou agissent en tant que contributeurs malveillants. Ces approches exploitent les angles morts des pipelines DevOps ainsi que la nature distribuée et ultra-rapide du développement logiciel. Les attaquants peuvent, par exemple, diffuser une version « cheval de Troie » d’un package npm populaire, lequel se retrouve discrètement embarqué dans des milliers d’applications dépendantes.
Types de logiciels malveillants dans les chaînes d’approvisionnement logicielles
Outre les types de logiciels malveillants traditionnels, les menaces spécifiques à la chaîne d’approvisionnement comprennent la confusion des dépendances (en anglais, dependency confusion), l’usurpation de marque (brandjacking) et le typosquatting. La confusion des dépendances, par exemple, se produit lorsque des packages internes sont accidentellement remplacés par des packages de même nom provenant de dépôts publics. Les attaquants exploitent cette faille en publiant des variantes infectées dans ces dépôts, de sorte que les pipelines CI/CD récupèrent leur code altéré plutôt que la version légitime.
Le brandjacking et le typosquattage consistent à créer des packages malveillants qui imitent de très près des modules de confiance, en pariant sur une faute de frappe d’un développeur ou sur une différence subtile passée inaperçue. Une fois inclus dans un build, ces packages usurpés se comportent comme des logiciels légitimes, jusqu’à ce qu’ils exécutent des actions malveillantes au cours de l’exécution ou du déploiement.
Les logiciels malveillants insérés dans la supply chain se révèlent, le plus souvent, plus subtils et plus pernicieux que les variantes classiques. Au lieu de lancer des attaques immédiates, ils se cachent souvent dans des composants de confiance, échappant ainsi à la détection pendant de longues périodes. Certains logiciels malveillants sont programmés pour s’activer dans des conditions spécifiques, ce qui ajoute une couche supplémentaire de furtivité.
Cela va de voleurs d’identifiants intégrés directement aux scripts, à des portes dérobées dissimulées discrètement dans des images de conteneur. Dans certains cas, des « bombes logiques » sont intégrées dans des packages, conçues pour être activées au moment du déploiement. Les attaquants peuvent également utiliser l’obscurcissement pour dissimuler du code nuisible dans les dépendances.
Un exemple largement cité est celui de la faille « SolarWinds Orion », où les attaquants ont glissé un code malveillant dans une mise à jour logicielle légitime. Dans l’affaire « event-stream », un attaquant a repris la main sur un package npm très utilisé et y a implanté du code malveillant pour siphonner des informations depuis des wallets crypto. Ce qui rend ces menaces particulièrement dangereuses, c’est qu’elles héritent de la crédibilité du projet ou du fournisseur en amont, contournant souvent les défenses périmétriques traditionnelles.
L’impact des logiciels open source sur les risques de logiciels malveillants
Les logiciels open source sont à la base de l’ingénierie logicielle moderne, mais leur utilisation généralisée en a également fait une cible attrayante pour les attaquants. Les organisations s’appuient souvent sur des centaines, voire des milliers de composants open source. C’est pourquoi il est si important de s’assurer que les packages sont soumis à une analyse des vulnérabilités avant d’entrer dans l’environnement de développement. Malheureusement, de nombreuses organisations intègrent automatiquement des packages de systèmes d’exploitation dans leurs projets, sans examen approfondi, ce qui crée un point d’entrée idéal pour les logiciels malveillants.
Les risques augmentent lorsque les projets sont mal entretenus, ou quand des attaquants compromettent des mainteneurs de confiance et y insèrent du code nuisible. Les développeurs peuvent, sans le savoir, intégrer des packages malveillants simplement en exécutant un npm install ou en ajoutant une dépendance avec des sous-dépendances non résolues.
Les compromissions de ua-parser-js et color.js/faker.js montrent à quel point les logiciels malveillants peuvent se propager rapidement une fois introduits dans des bibliothèques populaires. Dans les deux cas, le code malveillant s’est largement propagé avant d’être découvert. Ces incidents montrent comment un simple package open source peut servir de mécanisme de diffusion de logiciels malveillants à grande échelle.
Pour atténuer ces risques, les organisations doivent suivre et auditer leurs dépendances, privilégier les projets activement maintenus, verrouiller les versions pour éviter les mises à jour surprises et analyser régulièrement les composants avec des solutions de sécurité telles que JFrog Xray.
Pourquoi les attaques contre la chaîne d’approvisionnement logicielle se multiplient-elles ?
Les attaques contre la chaîne d’approvisionnement sont devenues plus fréquentes pour plusieurs raisons. La première est tout simplement que le processus de développement logiciel est devenu plus complexe. L’emploi de centaines d’outils, services et bibliothèques externes ouvre d’autant plus de brèches potentielles pour les attaquants. Cette complexité rend également plus difficile le maintien de la visibilité pour les équipes de sécurité.
La pression exercée sur le DevOps pour accélérer les cycles de développement et la livraison continue a accéléré le rythme des modifications logicielles, parfois au détriment d’un examen sécuritaire approfondi. On privilégie l’automatisation et la rapidité, au risque de créer des zones d’ombre exploitables par du code malveillant. De plus, l’opération est de plus en plus rentable pour les attaquants : compromettre un seul composant en amont peut impacter des milliers d’applications en aval.
Des acteurs étatiques ont également commencé à employer ces méthodes dans leur arsenal cyber, conscients de la portée et de la discrétion des compromissions de la chaîne d’approvisionnement. Le contexte plus large de la transformation numérique a amplifié l’urgence. Lorsque les entreprises adoptent les technologies cloud natives, les conteneurs et l’infrastructure en tant que code, elles introduisent souvent de nouveaux outils plus rapidement qu’elles ne les sécurisent, laissant leurs chaînes d’approvisionnement exposées.
Les failles de la sécurité
Bien qu’elles soient conscientes de ces risques, de nombreuses organisations ont du mal à déterminer exactement où leurs défenses échouent. Les lacunes en matière de sécurité découlent souvent d’un manque de visibilité : les équipes de développement ne connaissent peut-être même pas tous les composants sur lesquels reposent leurs applications. L’infrastructure existante et les outils obsolètes peuvent encore obscurcir la source et l’état des dépendances logicielles.
Les contraintes de temps sont également à l’origine de comportements à risque. Sous la pression des délais, les développeurs peuvent copier du code depuis des forums publics, désactiver des alertes de sécurité pour faire passer le build, ou s’appuyer sur des plugins non validés afin d’accélérer l’avancement. Même les équipes les plus consciencieuses finissent par connaître une « lassitude de la sécurité » : l’afflux permanent d’alertes pousse à passer à côté de menaces réelles, voire à les ignorer.
Ces défaillances ne sont pas toujours d’ordre technique. Le fonctionnement en silos, l’ambiguïté quant à qui possède la sécurité et des processus disparates contribuent tous à fragiliser la chaîne d’approvisionnement logicielle. Sans un effort coordonné entre l’ingénierie, la sécurité et les opérations, des malwares peuvent exploiter les failles, même au sein d’équipes de bonne volonté.
Renforcer la sécurité de votre chaîne d’approvisionnement logicielle
La réduction des risques liés aux logiciels malveillants ne se limite pas aux défenses périmétriques traditionnelles. Cela appelle un réflexe sécurité par défaut, sur l’ensemble du cycle de vie logiciel. L’adoption d’une approche DevSecOps permet d’intégrer la sécurité à chaque étape, du code et du build à la mise en production et à l’exécution.
L’une des pratiques les plus efficaces consiste à analyser en continu les artefacts dans le pipeline, au moyen d’outils automatisés de détection de vulnérabilités qui repèrent les failles connues dans les packages, conteneurs et binaires avant leur mise en production. La validation systématique des artefacts est cruciale : signature et vérification des packages, des images de conteneurs et des binaires pour s’assurer qu’ils sont authentiques.
Une nomenclature logicielle (SBOM) offre une transparence sur les composants d’une application. Savoir ce que contient votre logiciel, et d’où il vient, permet de réagir plus rapidement aux vulnérabilités nouvellement révélées. L’application automatisée des politiques peut réduire davantage les risques en bloquant les builds qui ne répondent pas aux critères de sécurité définis.
Le choix et l’examen minutieux des composants tiers constituent une autre pratique fondamentale. Les équipes doivent s’appuyer sur des sources fiables, appliquer le contrôle des versions et préférer les packages dont les responsables sont actifs et dont la sécurité est clairement établie. Intégrer la gestion des vulnérabilités permet non seulement d’identifier les menaces, mais aussi d’y remédier rapidement.
Comment JFrog renforce la sécurité de la chaîne d’approvisionnement logicielle
Les logiciels étant de plus en plus interconnectés, les logiciels malveillants dans la chaîne d’approvisionnement constituent une menace croissante et urgente. Les pratiques de développement modernes ont gagné en efficacité, mais elles ont aussi créé des angles morts. La protection de la chaîne d’approvisionnement logicielle ne consiste pas seulement à sécuriser le produit final, mais aussi chaque composant, contributeur et processus qui le touche.
Les organisations doivent adopter une attitude proactive en intégrant la sécurité dans l’ensemble de leurs workflows de développement. Il s’agit notamment d’adopter l’analyse automatisée, de maintenir la visibilité par le biais de SBOM, de valider les artefacts et de gérer soigneusement les dépendances des tiers. La résilience vient du fait que la sécurité est une fonction intégrée et continue, et non une porte à la fin du développement.
L’avenir de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement dépend de la transparence, de l’automatisation et du partage des responsabilités. Avec la bonne stratégie et les bons outils, les entreprises peuvent protéger leurs environnements sans compromettre la rapidité ou l’innovation.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web, organisez une visite virtuelle ou organisez une démonstration individuelle à votre convenance.